|
|
 |
|||||
 |
 |
|||||
 |
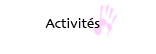 |
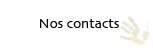 |
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Axe 1 - Culture, socialisation, curriculum Axe 2 - Égalité des chances et Équité
Axe 3 - Politiques et pratiques dans une
perspective comparative |
Axe 2 : Égalité des chances et équité (English version will follow) Cet axe comporte trois grands thèmes : 1) Performance et cheminement scolaires des élèves issus de l’immigration au Québec C’est sous ce thème que les développements les plus importants ont eu lieu cette année à la Chaire. Tout d’abord, nous avons finalisé le projet « La réussite scolaire des jeunes québécois issus de l’immigration au secondaire», soutenu par le MELS et mené conjointement avec Jacques Ledent (INRS) et Jake Murdoch (Université de Montréal). Ce projet consistait en un suivi systématique jusqu’au collégial des cohortes d’élèves québécois issus de l’immigration ayant intégré le secondaire 1 en 1998-1999 et 1999-2000, en contrastant à cet égard les réalités vécues dans les secteurs de langue française et de langue anglaise. Le rapport final déposé au MELS en août 2010 distingue ces élèves selon sept grande régions d’origine, selon leurs caractéristiques linguistiques (soit s’ils ont ou non la langue d’enseignement comme langue maternelle ou langue d’usage) et selon leur statut générationnel. On y aborde leurs caractéristiques sociodémographiques (sexe, lieu de résidence, lieu de naissance, milieu socio-économique) et scolaires (niveau d’entrée dans le système scolaire, âge à l’arrivée, densité ethnique et degré de défavorisation de l’établissement scolaire qu’ils fréquentent, désignation comme élève en difficulté, soutien linguistique) ainsi que divers indicateurs de leur cheminement et de leur performance scolaires (retard accumulé en secondaire 3, diplômation au secondaire, résultats en français, mathématiques et sciences). Des analyses de régression multiple permettent également de répondre à trois questions. Quels facteurs influencent la diplômation secondaire chez ces jeunes? Quel est leur impact respectif face à d’autres variables non considérées dans l’étude, qui relèvent des pratiques familiales ou scolaires? Et enfin, quand toutes leurs caractéristiques sont considérées, les élèves issus de l’immigration réussissent-ils aussi bien, mieux ou de manière équivalente que les élèves de deuxième génération ou plus? Dans l’ensemble, l’étude permet de dégager les constats suivants. 1) Tout d’abord, il apparaît que bien que leurs caractéristiques de départ soient nettement moins favorables, les élèves de première et de deuxième génération québécois ne constituent pas, dans leur ensemble, une population à risque élevé d’échec au sein du système scolaire. Leur résilience se manifeste tout particulièrement par l’augmentation de leur taux de diplômation lorsqu’ils bénéficient de deux ans supplémentaires pour terminer leurs études secondaires, ce qui pointe vers la pertinence des approches actuelles où l’adéquation entre l’âge de l’élève et son niveau de classement est moins rigide que par le passé. La grande motivation de ces élèves et de leurs parents se manifeste également par leur choix élevé des cours les plus sélectifs dans des matières comme les mathématiques et les sciences, ce qui illustre la valorisation des études supérieures qui prévaut dans les familles issues de l’immigration. 2) Ce constat positif cache cependant d’importantes variations selon le secteur linguistique, la génération, la langue d’usage à la maison et surtout la région d’origine. D’une part, les élèves de première génération, ceux qui ont une langue d’usage autre à la maison et de façon plus générale les élèves qui fréquentent le secteur français connaissent des problèmes spécifiques, même s’ils réussissent nettement mieux que leurs caractéristiques de départ ne le laisseraient attendre. D’autre part, les différences liées à l’origine (cernée par la région d’origine) sont confirmées par les analyses de régression, qui prennent pourtant en compte les caractéristiques plus ou moins favorables des élèves sur le plan sociodémographique et scolaire. 3) Ceci pointe vers la nécessité d’explorer dans quelle mesure ce résiduel est attribuable à des facteurs liés aux familles ou aux communautés (telles leurs pratiques ou leurs valeurs éducatives, leurs stratégies ou leur rapport à la scolarité) ou, au contraire, à des facteurs systémiques (tels les attentes des enseignants, les processus d’évaluation et de classement ou la représentation de divers groupes au sein du curriculum et du personnel scolaire). La variance importante entre les écoles et les commissions scolaires, non expliquée par les caractéristiques de leurs élèves, exige également de mieux identifier, par le biais d’études ethnographiques ou de recherches-action, ce qui caractérise les milieux « qui font une différence ». 4) Nos analyses ont également révélé que divers facteurs, largement partagés avec l’ensemble de la population scolaire, représentent des obstacles supplémentaires à la réussite des élèves de première et de deuxième génération, soit le fait d’être un garçon, fréquentant une école publique de milieu défavorisé, arrivé avec du retard au secondaire et de continuer d’en accumuler durant la scolarité secondaire. Les approches actuellement développées au Québec pour mieux soutenir ces catégories d’élèves sont donc très susceptibles d’avoir un impact positif sur la réussite des élèves issus de l’immigration, en autant que la spécificité de ce groupe-cible soit reconnue au sein de ces programmes. Par ailleurs, la réalisation de dix portraits spécifiques à chacune des régions d’origine étudiées (sept au secteur français, trois au secteur anglais), où les différences entre divers pays ou langues d’origine regroupés sous ces méta-catégories seront présentées et analysées, est actuellement en cours. Ce projet, qui a bénéficié d’un soutien additionnel du MELS, associe six étudiants gradués, d’institutions universitaires et de disciplines variées, qui pourront également utiliser ces données pour la rédaction d’articles scientifiques s’inscrivant dans la foulée de leurs intérêts et expertises de recherche. Par ailleurs, afin d’accentuer son leadership au plan national et international dans ce domaine d’une grande importante stratégique, la Chaire a pris l’initiative de regrouper l’ensemble des chercheurs du CEETUM ainsi que des partenaires-clés travaillant sur la question de la réussite scolaire, dans le cadre d’une équipe FQRSC en partenariat avec la Direction des services aux communautés culturelles et la Direction de la recherche, des statistiques et de l’information (DRSI) du MELS. En plus des trois chercheurs engagés dans nos études quantitatives antérieures sur le cheminement et la performance scolaires des jeunes issus de l’immigration, le Groupe de Recherche Immigration, équité et scolarisation (GRIES) regroupe un chercheur gouvernemental, Alain Carpentier (DRSI, MÉLS) un chercheur collégial, Sylvie Loslier (Cégep Édouard-Montpetit) ainsi que quatre chercheurs universitaires, Maryse Potvin (UQAM), Fasal Kanouté (UdeM), Michèle Vatz-Laaroussi (Université de Sherbrooke) et Françoise Armand (Université de Montréal) qui ont réalisé divers travaux, surtout qualitatifs sur le rôle des facteurs personnels, familiaux et communautaires ou des politiques, pratiques et dynamiques institutionnelles dans cette problématique. Le soutien obtenu du FQRSC (avril 2010-mai 2014) vise trois objectifs : une méta-analyse des résultats et une modélisation des facteurs identifiés dans les projets portant sur la scolarité obligatoire et l’éducation des adultes; le développement d’analyses comparatives sur le plan régional, national et international et, enfin, l’extension des travaux à l’éducation postsecondaire et à la transition vers le marché du travail. En 2010-2011, l’équipe concentrera l’essentiel de ses activités à la réalisation du premier objectif afin de paver la voie à la publication d’un ouvrage de synthèse prévu à l’an 2. Afin de situer clairement la question de la réussite scolaire des élèves issus de l’immigration dans la problématique plus large de la lutte à l’échec scolaire, des contacts seront spécifiquement développés avec d’autres groupes de recherche à caractère plus générique, tels le Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) et le Groupe de recherche sur les environnements scolaires (GRES). La dimension comparative sera également au cœur des analyses (voir point suivant). Par ailleurs, une extension des travaux à l’en-seignement supérieur sera amorcée par le biais d’une lettre d’intention actuellement en préparation, sous la coordination de Fasal Kanouté, dans le cadre de la nouvelle action concertée MELS-FQRSC-Programme de persévérance scolaire. Regroupant de nombreux chercheurs dont 3 chercheurs de l’équipe, ce projet se penchera sur l’adaptation des universités québécoises à leur clientèle pluriethnique, tout particulièrement celle des immigrants récents. Au-delà de ces travaux d’équipe, il faut signaler aussi un nouveau projet financé par le MELS, qui s’intéresse aux facteurs qui sont à l’origine du choix de la langue d’enseignement au niveau collégial chez les jeune Québécois allophones ou issus de l’immigration soumis, au primaire ou au secondaire, à la Loi 101. Ce projet, sous la responsabilité de Marie Mc Andrew et de Gérard Pinsonneault, chercheur associé à la Chaire, qui a mené une longue carrière à la Direction de la recherche du ministère de l’immigration et des communautés culturelles (MICC), se penche sur l’impact de la composition plus ou moins favorable au français des flux migratoires et des taux variables de diplômation secondaire et d’accès au collégial chez diverses communautés dans l’évolution temporelle du phénomène. On y explorera également, pour les cohortes plus récentes où cela est possible, les cheminements au niveau universitaire, afin de déterminer si les décisions prises au collégial sont révélatrices de choix linguistiques subséquents ou reflètent plutôt une stratégie de maximisation des compétences linguistiques. Enfin, un examen comparatif sera effectué afin de déterminer jusqu’à quel point le comportement des élèves issus de l’immigration est différent des autres élèves québécois.
2) Les facteurs d’influence et les conditions favorables à la réussite scolaire chez les minorités : comparaisons nationales et internationales En 2009-2010, les activités de la Chaire sous ce thème ont porté essentiellement sur la dissémination des travaux menés entre 2006 et 2009. En plus de tenir notre activité majeure sur ce thème en 2009 (voir présence de la Chaire au sein de la collectivité, page 27), nous avons été particulièrement actifs dans la diffusion des résultats du projet « La performance et le cheminement scolaires des jeunes issus de l’immigration à Montréal, Toronto et Vancouver», dont le rapport annuel avait été soumis l’an dernier au Conseil canadien de l’apprentissage et par Citoyenneté et Immigration Canada (voir Rapport annuel 2008-2009 pour une synthèse des résultats). Trois articles ont été publiés ou acceptés dans des revues scientifiques ou de vulgarisation, entre autres, «Les carrières scolaires des jeunes allophones à Montréal, Toronto et Vancouver : une analyse comparative »(Revue de l’Intégration et de la Migration Internationale),«La diplômation au secondaire des jeunes issus de l’immigration: une analyse comparative de Montréal, Toronto et Vancouver».(Nos diverses cités/Our Divers Cities, aussi publié en anglais) et «Le cheminement scolaire des jeunes allophones à Montréal». (Revue Vie Pédagogique) Une dizaine de présentations des résultats ont également été faites, tant par l’équipe de Montréal que par celles de Toronto et de Vancouver, entre autres dans le cadre du colloque international «La réussite scolaire des élèves issus de l’immigration», organisé par la Chaire en novembre 2009, ou de réunions spécifiquement organisées à l’intention des décideurs. Nous avons également poursuivi un ensemble d’opérations visant à assurer le développement de nouvelles initiatives comparatives. D’une part, dans le cadre du colloque Metropolis de mars 2010, une rencontre regroupant l’ensemble des chercheurs et partenaires associés au projet Montréal-Toronto-Vancouver ainsi que les représentants de CIC, a permis de d’amorcer la mise sur pied d’un groupe d’intérêt pancanadien sur le cheminement postsecondaire des jeunes issus de l’immigration. Une demande d’appoint pour soutenir ce réseau a été soumise à la direction de la recherche de CIC, qui, faute de fonds cette année, n’a pu la soutenir. Nous sommes actuellement à la recherche de stratégies alternatives à cet égard. D’autre part, sur le plan international, la titulaire a continué de participer au Comité-conseil du réseau The Integration of the European Second Generation Research Training network (TIES-RTN), entre autres en agissant à titre de discustant, lors de la conférence finale de ce projet tenu à Paris du 26 au 28 mai 2010, dans le cadre de la session sur l’Éducation. De plus, la collaboration avec la Flandres s’est nettement intensifiée. La titulaire a été nommée au Comité aviseur du projet, «School, youngsters, parents and neighbourhood: partners in the creation of an optimal school career» que mènent 5 chercheurs flamands de 3 universités, sous la direction de Christiane Timmerman. Elle a participé à la seconde réunion de ce comité aviseur, le 21 mai à l’Université d’Anvers, où elle a pu se familiariser avec les nombreux volets, quantitatifs et qualitatifs, de ce projet et réagir aux enjeux théoriques ou défis méthodologiques auxquels sont confrontée l’équipe, en fonction de l’expertise québécoise et canadienne. Au fur et à mesure que les activités de la nouvelle équipe FQRSC se préciseront, nous serons plus en mesure d’identifier les domaines de collaboration les plus féconds avec ces partenaires. À plus court terme, mentionnons que Michèle Vatz-Laaroussi a effectué un séjour de recherche au sein de l’Intercultural Migration and Minority Research Centre de la Catholic University of Leuven pour travailler avec les professeur Philippe Hermanns et John Leman sur le rôle des stratégies familiales et communautaires dans la réussite scolaire des jeunes immigrants. De plus, ces chercheurs nous visiteront en novembre prochain, dans le cadre d’un atelier intensif que nous prévoyons organiser sur cette thématique. Cet atelier associera également Carola Suarez-Orozco qui a dirigé, à l’Université de New York, une étude longitudinale de cinq ans sur le cheminement des élèves issus de l’immigration dans trois États américains, qui se caractérise, entre autres, par une association novatrice de données quantitatives et qualitatives (entre autres sur les stratégies communautaires et les facteurs systémiques) dans l’étude du phénomène. Par ailleurs, il faut souligner l’apport de notre postdoctorante 2008-2009, Madame Henda Ben Salah, aux travaux relatifs à ce thème. En effet, en plus d’être responsable de l’organisation du colloque international sur la réussite des élèves issus de l’immigration, madame Ben Salah a mené une étude comparative (Québec, Ontario et Colombie-Britannique), à partir de l’enquête longitudinale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) 1994-2007, intitulée Les carrières scolaires des élèves issus de l'immigration au Canada au secondaire : entre aspirations et réalisations. Dans le cadre de cette étude économétrique, elle a examiné les liens entre les carrières scolaires effectivement réalisées par les enfants et les vœux émis par les parents au début de l’entrée de l’élève au secondaire. Ce projet apporte un complément aux travaux de la Chaire qui n’explorent que les facteurs sociodémographiques ou scolaires. Les résultats de cette étude illustrent le poids déterminant du capital culturel chez les familles issus de l’immigration au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique tant sur la formulation des fortes attentes familiales par les parents que sur les réalisations scolaires de l’enfant. Ils montrent également que les parents intériorisent fortement les mauvaises performances de leurs enfants. Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs présentations et de deux articles accepté ou soumis à des revues nationales ou internationales (Thèmes Canadiens et Revue européenne des migrations internationales). 3) Éducation et intervention antiracistes La Chaire n’a pas mené de recherche spécifique sur cette question cette année, bien qu’une grande partie des travaux sur le cheminement scolaire des élèves issus de l’immigration y touche directement ou indirectement. C’est le cas, notamment, de l’étude particulièrement novatrice menée à l’éducation des adultes par Maryse Potvin, où les logiques systémiques et les pratiques de classement qui produisent de l’exclusion et de la discrimination sont spécifiquement explorées. De plus, sous l’égide de cette chercheure, diverses activités ont été amorcées qui devraient générer des développements importants en 2010-2011. D’une part, le programme CRSH ci-haut mentionné « Le rôle de l’éducation dans les relations entre la communauté juive et les Québécois d’autres origines », comporte un troisième axe portant sur l’impact pédagogique des lieux de mémoire et des initiatives communautaires sur l’éducation interculturelle et antiraciste québécoise, sous sa responsabilité, qui associe également Benoit Côté (Université de Sherbrooke) ainsi que la titulaire. Celui-ci vise, d’une part, à cartographier les activités menées par la communauté juive en milieu scolaire à la lumière de la littérature sur les conditions de mise en œuvre favorables au développement des attitudes et compétences interculturelles et antiracistes chez les élèves (An 1 du projet) et, d’autre part, à plus long terme, à évaluer l’impact d’une de ces initiatives, la visite du Centre commémoratif de l’Holocauste et la participation aux activités pédagogiques, qui y sont associées, sur les élèves et les enseignants. Les questions soulevées par ce projet sont au cœur de débats très actuels dans le domaine de l’éducation antiraciste ou de l’enseignement de l’Holocauste. Il s’agit, d’une part, de cerner les conditions de mise en œuvre qui font en sorte que les activités de sensibilisation ont ou non un impact à plus long terme sur les attitudes, perceptions et stéréotypes et, d’autre part, d’identifier les approches pédagogiques qui permettent aux élèves de généraliser les apprentissages réalisés sur des événements extrêmes, tels que les génocides, à des situations moins criantes de tension intercommunautaire. D’autre part, la Chaire, en collaboration avec le CEETUM, le MELS et la Fondation de la Tolérance, tiendra les 31 mars et 1er avril, deux journées d’études intitulées « Pour une éducation inclusive au Québec : pratiques, recherche et formation », dont l’organisation a été confiée à notre postdoctorante Geneviève Audet. Sous le concept d’éducation inclusive, on regroupe divers courants qui visent le développement des compétences de tous les élèves à vivre dans une société égalitaire et pluraliste. Dans la foulée du séminaire fermé « Racisme, antisémitisme et discrimination en éducation : comment transformer les données de la recherche en outils pédagogiques et en pratiques » organisé par Maryse Potvin le 13 mars 2009, cet événement veut s’adresser à un public élargi de praticiens du milieu scolaire, soit les directions d’école, les conseillers pédagogiques, les enseignants et les autres professionnels non enseignants. On vise, à court terme, à développer une compréhension commune des concepts et des débats associés à l’éducation inclusive et à permettre le partage de diverses initiatives réussies des milieux scolaire et communautaire, tout en favorisant l’appropriation des résultats de diverses recherches par les praticiens. À plus long terme, l’objectif est de mettre en œuvre un réseau de réflexion et d’intervention sur l’éducation inclusive au Québec. Le colloque est financé principalement par le MELS, mais permettra également de concrétiser une nouvelle collaboration avec la Fondation de la Tolérance, la titulaire ayant récemment été nommée présidente du Comité conseil de cet organisme. ************************************************************** Component 2 – Equal Opportunity and Equity This component includes three main themes: 1) The Academic Performance and Educational Pathways of Quebec Youth of Immigrant Origin It is under this theme that the most important developments of the Chair have taken place this year. First of all, we completed the project “La réussite scolaire des jeunes québécois issus de l’immigration au secondaire” (Translated: Educational Success among Quebec Youth of Immigrant Origin in High School), funded by MELS and carried out in collaboration with Jacques Ledent (INRS) and Jake Murdoch (Université de Montréal). This project consisted in systematically following until college a cohort of Quebec students of immigrant origin who began their first year of secondary school in 1998-1999 and 1999-2000, contrasting experiences of the French and English sectors in this regard. The final report submitted to MELS in August 2010 considers these students according to seven main regions of origin, their linguistic backgrounds (whether or not their language of instruction is the same as that used at home), and their generational status as immigrants. The report covers their socio-demographic features (sex, place of residence, birthplace, socio-economic milieu) and educational characteristics (level at which they entered the school system, age upon arrival, ethnic concentration and degree of disadvantage in the school they attend, designation as high needs students, linguistic support), as well as various indicators for their educational pathways and performance (accumulated delay in the 3rd year of high school, graduation rates, results in French/English, Math and Sciences). Multiple regressive analyses permit us to answer three questions. What factors influence high school graduation among these youth? What is the impact of such factors with respect to other variables not considered in this study linked to family or school practices? And finally, when all these characteristics are considered, do students of immigrant origins succeed as much as, better, or in an equivalent manner to third generation (and beyond) students? Altogether, the study permits us to draw out the following observations. 1) First, it appears that even though their initial characteristics are clearly less favourable, overall first and second generation Quebec students do not constitute a population with a high risk of failure in the school system. Their resilience is particularly obvious in their rate of graduation, when they benefit from two additional years to complete their secondary studies, which suggests the adequacy of current approaches in which the correlation between the age of students and their assigned grade levels is less rigid than in years past. The strong motivation of these students and of their parents is also evident in their frequent choice of the most competitive courses in subjects such as maths and sciences, demonstrating the valuing of higher studies that is prevalent among families of immigrant backgrounds. 2) Nevertheless, this positive observation conceals important variations according to the linguistic sector, generation, language use at home, and above all region of origin. On one hand, first generation students, those whose home language is other than that of instruction and more generally students who attend the French sector face specific problems, even if their overall success is better than their initial characteristics would lead us to expect. On the other hand, differences linked to ethnic background (measured here by their region of origin) are confirmed by the regression analysis, even if the latter takes into account the more or less favourable characteristics of students at the socio-demographic and educational levels. 3) This suggests the need to explore to what degree residual effects can be attributed to factors related to the family or community (such as educational practices and values, their strategies, or their relationships to schooling), or by contrast to systemic factors (such as teacher expectations, processes of evaluation and grading, or the representation of various groups in the curriculum and among the school personnel). Significant variation between schools and school boards that cannot be explained by the characteristics of the students they receive also prompts us to better identify, by means of ethnographic studies and action-based research, that which most characterizes milieus that “make a difference.” 4) Our analysis also shows that various factors, largely shared with the full student body, also represent additional obstacles to the success of first and second generation students. Among these are: being a boy, attending a public school situated in a disadvantaged milieu, entering secondary school with delay and further accumulating this during one’s high school studies. Current approaches developed in Quebec to better support these categories of students are therefore very likely to have a positive impact on the success of students with immigrant backgrounds, as long as the specific needs of this target group are recognized within these programs. The production of ten portraits focusing on each of the regions of origin studied (seven in the French sector, three in the English), where differences between various countries of origin or languages gathered under these meta-categories are presented and analyzed, is also currently in progress. This project, thanks to additional support from MELS, involves six university graduate students from various disciplines, who can also use these data in the writing of scientific articles in line with their research interests and expertise. Furthermore, in order to increase its national and international leadership in this domain of great strategic significance, the Chair took the initiative to bring together researchers from the CEETUM and key partners also working on issues of educational success, under the framework of an FQRSC team in partnership with the Direction des services aux communautés culturelles et la Direction de la recherche, des statistiques et de l’information (DRSI) (Cultural Communities Service Unit, and Research, Statistics and Information Unit) of MELS. In addition to three researchers engaged in our earlier quantitative studies on the educational pathways and performance of youth of immigrant origin, the Groupe de recherche Immigration, équité et scolarisation (GRIES) (Immigration, Equity, and Schooling Research Group) brings together a government researcher, Alain Carpentier (DRSI, MELS); a researcher from the college level, Sylvie Loslier (Cégep Édouard-Montpetit); and four university researchers, Maryse Potvin (UQAM), Fasal Kanouté (UdeM), Michèle Vatz-Laaroussi (Université de Sherbrooke) et Françoise Armand (Université de Montréal) who have carried out diverse studies, especially of a qualitative nature, on the role of personal, familial, and community factors, or institutional policies, practices, and dynamics in this area. Funding received from the FQRSC (April 2010-May 2014) anticipates three objectives: a meta-analysis of results and modelling of factors identified in projects addressing compulsory schooling and adult education; the development of comparative analyses at the regional, national, and international levels, and lastly, the extension of work to post-secondary education and transition towards the job market. In 2010-2011, the team will concentrate the majority of its activities on its first objective of laying the groundwork for the publication of a work of synthesis expected for the second year. In order to clearly situate the issue of school success of immigrant origin students within the broader framework of the struggle against educational failure, contacts will be specifically developed with other more generic research groups, such as the Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) (Research and Intervention Centre on School Success) and the Groupe de recherche sur les environnements scolaires (GRES) (Research Group on Educational Environments). The comparative dimension will also be at the heart of these analyses (See the following point). What is more, an extension to work on higher education will begin by way of a letter of intent currently being prepared under the coordination of Fasal Kanouté, as part of the new joint program between the MELS-FQRSC on Student Retention and Academic success. Bringing together researchers, including three from the team, this project will focus on the adaptation of Quebec universities to their pluri-ethnic clientele, particularly to recent immigrants. Beyond these team endeavours, it is also important to stress a new project funded by the MELS, exploring the factors that influence the choice of language of instruction at the college level among young Allophone or immigrant origin Quebeckers who in primary and secondary school were submitted to Bill 101. This project, under the responsibility of Marie McAndrew and Gérard Pinsonneault, an associate researcher with the Chair who has had a long career in the Direction de la recherche du ministère de l’immigration et des communautés culturelles (MICC), explores the impacts of two trends in the evolution of the phenomenon: the greater or lesser favourability to French of the language composition of migratory flows, and the varying rates of high school completion and access to college among various communities affected by this phenomenon. We also study university-level pathways, when possible among more recent cohorts, as a means of determining whether decisions made at the college-level are indicative of subsequent linguistic choices, or whether these instead reflect a strategy to maximize linguistic abilities. Ultimately, a comparative study will be conducted to determine to which point the behaviour of students of immigrant origin is different from that of other Quebec students. 2) Factors and Conditions Favourable to Educational Success among Minorities: National and International Comparisons In 2009-2010, the Chair’s activities under this theme have mostly focused on the dissemination of works carried out between 2006 and 2009. In addition to having held our major activity in this theme in 2009 (See the Chair’s presence in the community, page 28), we have been particularly active in the diffusion of results of the project “La performance et le cheminement scolaires des jeunes issus de l’immigration à Montréal, Toronto et Vancouver” (Translated: Academic Performance and Educational Pathways among Youth of Immigrant Origin in Montreal, Toronto and Vancouver), for which the final report was submitted last year to the Conseil canadien de l’apprentissage and Citizenship and Immigration Canada (See Annual Report 2008-2009 for a synthesis of results). Three articles were published or accepted by scientific or professional journals, among others “Les carrières scolaires des jeunes allophones à Montréal, Toronto et Vancouver : une analyse comparative” (Translated: The School Careers of Young Allophones in Montreal, Toronto and Vancouver) in the Revue de l’Intégration et de la Migration Internationale, “La diplômation au secondaire des jeunes issus de l’immigration: une analyse comparative de Montréal, Toronto et Vancouver” (Translated: High School Graduation among Youth of Immigrant Background: a Comparative Analysis of Montreal, Toronto, and Vancouver” in Nos diverses cités/Our Diverse Cities (also published in English) and “Le cheminement scolaire des jeunes allophones à Montréal” (Translated: School Pathways of Allophone Youth in Montreal) in Revue Vie Pédagogique. Ten presentations of results were also made, by the Montreal team, as well as by those in Toronto and Vancouver, among others as part of the international colloquium “La réussite scolaire des élèves issus de l’immigration” (Translated: The Academic Achievement of Immigrant Origin Students), organized by the Chair in November 2009, as well as at meetings specifically targetting decision-makers. We have also engaged in a number of pursuits directed at ensuring the development of new comparative initiatives. On one hand, as part of the Metropolis conference in March 2010, a meeting bringing together all the researchers and affiliated partners in the Montreal, Toronto and Vancouver project, as well as representatives from the CIC, set the stage for the setting of a Pan-Canadian interest group on post-secondary pathways among youth of immigrant origin. A seed-money request to fund this network was submitted to the research director of CIC, who for lack of funds this year was unable to support it. We are currently seeking alternative strategies in this respect. On the other hand, at the international level, the Chair continued to participate in the advisory committee of the Integration of the Second Generation in Europe Research Training Network (TIES-RTN), among other things acting as discussant in the final conference of this project held in Paris between May 26-28, 2010, during the session on Education. Further, the collaboration with Flanders clearly intensified. The chair was named to the Advisory Committee of the project “School, Youngsters, Parents and Neighbourhood: Partners in the Creation of an Optimal School Career” that involves five Flemish researchers from three universities, under the supervision of Christiane Timmerman. She participated in the second meeting of this advisory committee on May 21 at Antwerp University, where she was able to familiarize herself with the various aspects of this project, both quantitative and qualitative, and to contribute to discussion surrounding various theoretical issues and methodological challenges confronting the team, based on her Quebec and Canadian expertise. As the activities of the new FQRSC team become specified, we will be in a better position to determine the most fruitful domains for collaboration with these partners. In the shorter term, one must mention that Michèle Vatz-Laaroussi made a research visit to the Intercultural Migration and Minority Research Centre at the Catholic University of Leuven in order to work with Professors Philippe Hermanns and John Leman on the role of family and community strategies in the educational success of young immigrants. Furthermore, these researchers will visit us next November as part of an intensive workshop that we anticipate organizing on these themes. This workshop will also involve Carola Suarez-Orozco, who has directed at New York University a five-year longitudinal survey on the pathways of students of immigrant origin in three American states. Her study is known, among other features, for an innovative combination of quantitative and qualitative data (including on community strategies and systemic factors) in the study of this phenomenon. Additionally, it is important to highlight the contribution of our post-doctoral fellow for 2008-2009 Henda Ben Salah, whose work relates to this theme. As well as being responsible for the organization of the international colloquium on the success of students of immigrant origin, H. Ben Salah has carried out a comparative study (Quebec, Ontario and British Columbia), using the longitudinal survey on children and youth (ELNEJ) 1994-2007 titled Les carrières scolaires des élèves issus de l'immigration au Canada au secondaire : entre aspirations et realisations (Translated: Educational Pathways of High School Students of Immigrant Origin in Canada: Between Aspirations and Accomplishments). In the framework of this econometric study, she examined ties between the educational pathways actually realized by children and the desires of their parents upon student entry into high school. This project complements other work by the Chair that focuses only on socio-demographic and educational factors. The results of this study illustrate the determining weight that cultural capital among immigrant families in Quebec, Ontario and British Columbia plays not only in the high expectations of parents, but also in the educational achievements of children. They also demonstrate that parents deeply internalize the poor performances of their children. This work has been the focus of a number of presentations and two articles accepted or submitted to national and international journals (Thèmes Canadiens and Revue européenne des migrations internationales).
3) Anti-Racist Education and Intervention
First, the SSRHC program mentioned above “Le rôle de l’éducation dans les relations entre la communauté juive et les Québécois d’autres origins” (Translated: The Role of Education in the Relationship between the Jewish Community and Quebeckers of Other Origins), comprises a third component focusing on the educational impact of sites of memory and community initiatives on inter-cultural and anti-racist education in Quebec. Under Potvin’s responsibility, this also involves Benoit Côté (Université de Sherbrooke), as well as the Chair. It aims to, on the one hand, chart activities pursued by the Jewish community in the educational milieu in light of literature on the conditions for fostering the development of inter-cultural and anti-racist attitudes and abilities among students (Year 1 of the project). On the other hand and in the longer term, it aims to evaluate the impact on students and teachers of one of these initiatives, the visit of the Holocaust Memorial Centre and participation in associated educational activities. This involves appreciating the conditions that permit or not activities of sensitization to have a more long-term impact on attitudes, perceptions and stereotypes. It also entails identifying pedagogical approaches that permit students to generalize learning about extreme events, such as genocides, to less obvious situations of inter-community tension. Second, in collaboration with the CEETUM, the MELS and the Fondation de la Tolérance, the Chair will host two study days on March 31 and April 1 titled “Pour une éducation inclusive au Québec : pratiques, recherche et formation,” (Translated: Towards an Inclusive Education in Quebec: Practices, Research and Training), whose organization has been assigned to our post-doctoral fellow Geneviève Audet. Under the concept of inclusive education, we gather together several currents that aim to develop abilities among all students to live in an egalitarian and pluralist society. In the wake of the closed seminar “Racisme, antisémitisme et discrimination en éducation : comment transformer les données de la recherche en outils pédagogiques et en pratiques” (Translated: Racism, Anti-Semitism and Discrimination in Education: Transforming Research Data into Educational Tools and Practices) organized by Maryse Potvin on March 13, 2009, this event aims to address a broader public of practitioners in the educational sector, either school principals, pedagogical advisors, or teachers and other non-teaching professionals. In the short term, we intend to develop a common understanding of concepts and debates relating to inclusive education and to foster the sharing of various successful initiatives carried out in the education and community milieus. We also hope to support the familiarization and the translation into action of various research results by practitioners. In the longer term, the goal is to establish a network for reflection on and dissemination of inclusive education in Quebec. The colloquium is mainly funded by the MELS, but will also allow for the realization of a new collaboration with The Tolerance Foundation, the Chair having recently been named president of the Advisory Committee of this organization.
|
|||||
